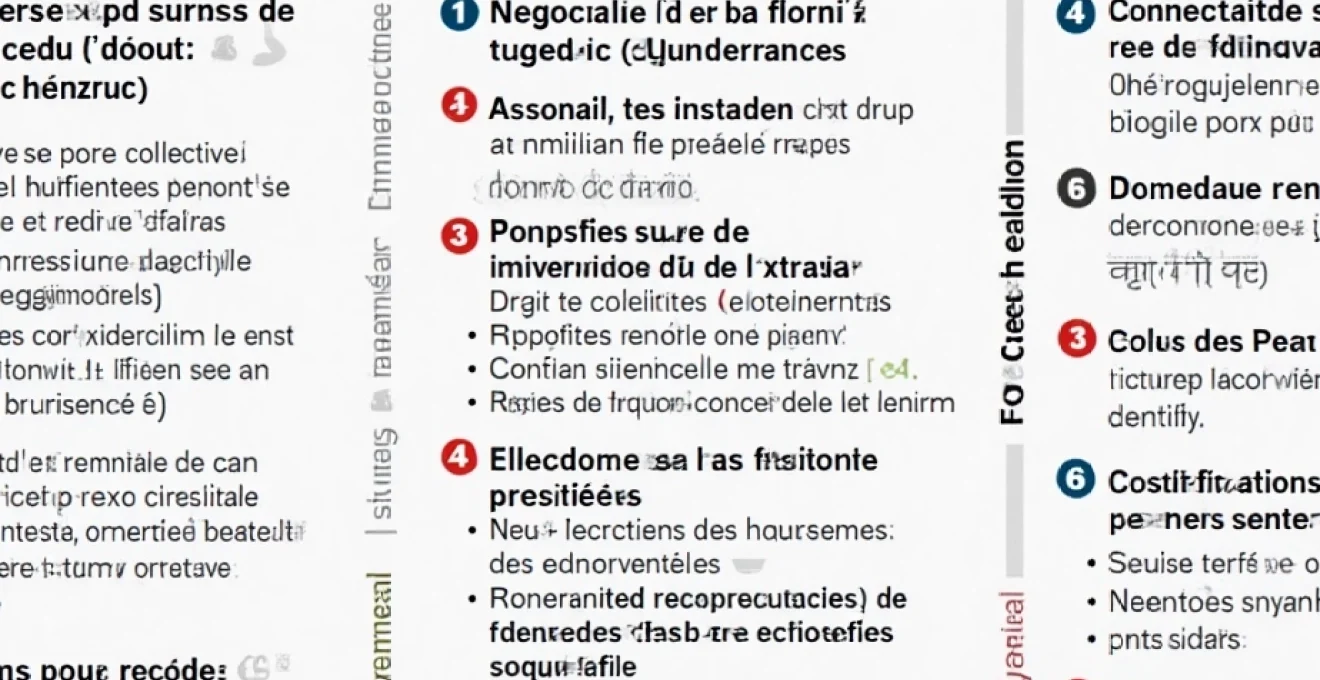
L’ordonnance du 22 septembre 2017 marque un tournant majeur dans le droit du travail français. Cette réforme ambitieuse vise à moderniser les relations professionnelles et à offrir plus de flexibilité aux entreprises tout en préservant les droits fondamentaux des salariés. Les changements apportés touchent de nombreux aspects du Code du travail, de la négociation collective à la représentation du personnel, en passant par les procédures de licenciement. Pour les employeurs comme pour les salariés, il est crucial de comprendre ces nouvelles dispositions qui redéfinissent le cadre juridique des relations de travail en France.
Contexte juridique de l’ordonnance du 22 septembre 2017
L’ordonnance du 22 septembre 2017 s’inscrit dans une volonté politique de réformer en profondeur le droit du travail français. Cette réforme fait suite à plusieurs tentatives précédentes, notamment la loi El Khomri de 2016, qui avaient déjà amorcé certains changements. L’objectif affiché est de simplifier le Code du travail, considéré comme trop complexe et rigide par de nombreux acteurs économiques.
Le gouvernement a choisi la voie des ordonnances pour mener à bien cette réforme, une procédure qui permet d’accélérer le processus législatif. Cette méthode a suscité des débats, certains y voyant un contournement du processus démocratique traditionnel. Néanmoins, les ordonnances ont été ratifiées par le Parlement en 2018, leur conférant ainsi une valeur législative pleine et entière.
L’ordonnance s’articule autour de plusieurs axes majeurs : la refonte de la hiérarchie des normes en droit du travail, la fusion des instances représentatives du personnel, la sécurisation des relations de travail, et l’assouplissement de certaines règles, notamment en matière de licenciement.
Réforme du code du travail : principaux changements
Négociation collective et accords d’entreprise
L’un des changements les plus significatifs apportés par l’ordonnance concerne la hiérarchie des normes en droit du travail. Traditionnellement, les accords de branche primaient sur les accords d’entreprise. L’ordonnance inverse cette logique dans de nombreux domaines, donnant la primauté aux accords d’entreprise.
Désormais, les accords d’entreprise peuvent déroger aux accords de branche, même dans un sens moins favorable aux salariés, sauf dans certains domaines spécifiques. Cette nouvelle architecture vise à permettre une adaptation plus fine des règles aux réalités de chaque entreprise. Les domaines où l’accord de branche reste prédominant sont notamment les salaires minima, les classifications, la mutualisation des fonds de formation professionnelle, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cette réforme encourage donc la négociation au niveau de l’entreprise, censée être plus proche des réalités du terrain. Elle soulève néanmoins des interrogations quant à la protection des salariés dans les petites entreprises, où le rapport de force peut être défavorable aux travailleurs.
Fusion des instances représentatives du personnel
L’ordonnance du 22 septembre 2017 a introduit une modification majeure dans la représentation du personnel au sein des entreprises : la création du Comité Social et Économique (CSE). Cette nouvelle instance unique remplace les trois instances représentatives du personnel préexistantes : les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Le CSE doit être mis en place dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés. Ses attributions varient selon la taille de l’entreprise. Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, le CSE reprend essentiellement les attributions des anciens délégués du personnel. Pour les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE exerce l’ensemble des attributions en matière de réclamation, d’information et de consultation sur les questions économiques et sociales.
Cette fusion vise à simplifier le dialogue social et à le rendre plus efficace. Cependant, certains syndicats craignent une dilution des missions spécifiques, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, auparavant dévolues au CHSCT.
Barème des indemnités prud’homales
L’une des mesures les plus controversées de l’ordonnance est l’instauration d’un barème obligatoire pour les indemnités prud’homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce barème fixe un plancher et un plafond d’indemnisation en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise.
L’objectif affiché est de sécuriser les relations de travail en rendant plus prévisible le coût d’un éventuel contentieux pour l’employeur. Cependant, cette mesure a été critiquée par les syndicats et certains juristes qui y voient une atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice et une limitation du pouvoir d’appréciation des juges.
Le barème des indemnités prud’homales vise à apporter plus de prévisibilité juridique, mais son application soulève des questions quant à l’équité de la réparation du préjudice subi par le salarié.
Il est important de noter que ce barème ne s’applique pas dans certains cas, notamment pour les licenciements nuls (discrimination, harcèlement, etc.) ou lorsque le licenciement porte atteinte à une liberté fondamentale.
Assouplissement du licenciement économique
L’ordonnance apporte également des modifications significatives en matière de licenciement économique. L’une des principales nouveautés concerne l’appréciation des difficultés économiques justifiant un licenciement. Désormais, cette appréciation se fait au niveau national pour les entreprises appartenant à un groupe international, et non plus à l’échelle mondiale comme c’était le cas auparavant.
Cette mesure vise à faciliter les restructurations pour les entreprises implantées en France, même si leur groupe est bénéficiaire à l’échelle mondiale. Elle soulève néanmoins des inquiétudes quant à la protection des emplois face à des stratégies d’optimisation fiscale ou sociale à l’échelle internationale.
Par ailleurs, l’ordonnance simplifie les obligations de reclassement de l’employeur en cas de licenciement économique. L’employeur peut désormais se contenter de diffuser la liste des postes disponibles sur un support accessible à tous les salariés, sans avoir à faire des propositions individualisées.
Impact sur le contrat de travail
Modification du CDI de chantier
L’ordonnance du 22 septembre 2017 a élargi les possibilités de recours au contrat à durée indéterminée (CDI) de chantier, rebaptisé « CDI de projet ». Auparavant limité principalement au secteur du bâtiment et des travaux publics, ce type de contrat peut désormais être utilisé dans d’autres secteurs d’activité, sous réserve qu’un accord de branche étendu le prévoie.
Le CDI de projet permet à l’employeur de rompre le contrat une fois le chantier ou le projet terminé, sans que cela soit considéré comme un licenciement économique. Cette mesure vise à offrir plus de flexibilité aux entreprises pour s’adapter aux fluctuations de leur activité. Cependant, elle soulève des interrogations quant à la sécurité de l’emploi pour les salariés concernés.
Les accords de branche définissant les modalités du CDI de projet doivent préciser les garanties offertes aux salariés, notamment en termes de formation et d’accompagnement. L’objectif est de trouver un équilibre entre flexibilité pour l’entreprise et sécurisation du parcours professionnel pour le salarié.
Télétravail et droit à la déconnexion
L’ordonnance apporte également des précisions sur le cadre juridique du télétravail, une modalité de travail en plein essor. Elle simplifie la mise en place du télétravail en supprimant l’obligation de l’inscrire dans le contrat de travail. Un simple accord entre l’employeur et le salarié, même par email, suffit désormais.
Par ailleurs, l’ordonnance renforce le droit à la déconnexion des salariés. Elle impose aux entreprises de négocier sur ce sujet dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur la qualité de vie au travail. L’objectif est de garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle à l’ère du numérique.
Le développement du télétravail et la reconnaissance du droit à la déconnexion témoignent de l’évolution des modes de travail et de la nécessité d’adapter le droit aux nouvelles réalités technologiques.
Ces dispositions visent à encadrer les pratiques de télétravail tout en offrant plus de souplesse dans leur mise en œuvre. Elles répondent à une demande croissante des salariés pour plus de flexibilité dans l’organisation de leur travail.
Rupture conventionnelle collective
L’ordonnance introduit un nouveau dispositif de rupture du contrat de travail : la rupture conventionnelle collective (RCC). Ce mécanisme permet à une entreprise de proposer à ses salariés, sur la base du volontariat, un plan de départs négocié collectivement, sans avoir à justifier de difficultés économiques.
La RCC doit faire l’objet d’un accord collectif majoritaire qui définit le nombre maximal de départs envisagés, les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier, les modalités de calcul des indemnités de rupture, et les mesures d’accompagnement des salariés. Cet accord doit être validé par l’administration du travail.
Ce nouveau dispositif se distingue du plan de départs volontaires classique par son cadre juridique spécifique et par l’absence de motif économique nécessaire. Il offre une alternative aux plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour les entreprises souhaitant réduire leurs effectifs de manière consensuelle.
Nouvelles règles pour le dialogue social
Rôle renforcé du comité social et économique (CSE)
Le Comité Social et Économique (CSE), instauré par l’ordonnance du 22 septembre 2017, joue désormais un rôle central dans le dialogue social au sein des entreprises. Cette instance unique, qui remplace les anciennes instances représentatives du personnel, voit ses prérogatives élargies et renforcées.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE est consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. Il dispose de moyens d’action et d’expertise pour exercer ses missions. Le CSE peut notamment mandater des experts pour l’assister dans l’analyse des informations économiques et sociales de l’entreprise.
L’ordonnance prévoit également la possibilité de créer, par accord d’entreprise, un conseil d’entreprise. Cette instance, qui intègre les prérogatives du CSE et des délégués syndicaux, a le pouvoir de négocier, conclure et réviser les accords collectifs. Cette innovation vise à simplifier encore davantage le dialogue social, mais son adoption reste à la discrétion des partenaires sociaux dans chaque entreprise.
Négociations obligatoires revisitées
L’ordonnance modifie le cadre des négociations obligatoires en entreprise. Elle offre plus de souplesse dans la périodicité et le contenu de ces négociations, tout en maintenant leur caractère obligatoire sur certains thèmes essentiels.
Désormais, un accord d’entreprise peut définir le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise. En l’absence d’accord, les règles supplétives prévoient trois blocs de négociation obligatoire :
- La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (annuelle)
- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (annuelle)
- La gestion des emplois et des parcours professionnels (triennale dans les entreprises d’au moins 300 salariés)
Cette flexibilité accrue vise à adapter le rythme et le contenu des négociations aux spécificités de chaque entreprise, tout en garantissant que les sujets essentiels sont abordés régulièrement.
Conséquences pour les PME et TPE
Simplification des procédures pour les petites entreprises
L’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit des dispositions spécifiques pour simplifier le dialogue social dans les petites et moyennes entreprises (PME) et les très petites entreprises (TPE). Ces mesures visent à adapter les obligations légales à la réalité de ces structures qui n’ont pas toujours les moyens ou l’expertise pour mettre en place des processus complexes.
Dans les entreprises de moins de 20 salariés dépourvues de délégué syndical, l’employeur peut désormais proposer un projet d’accord directement aux salariés. Ce projet doit être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel pour être valide. Cette disposition permet aux plus petites entreprises de conclure des accords collectifs sans passer par la négociation avec un représentant syndical.
Pour les entreprises de 11 à 49 salariés, l’ordonnance simplifie les modalités de négociation en l’absence de délégué syndical. Les accords peuvent être négociés, conclus et révisés par un salarié mandaté par une organisation syndicale ou par un membre de la délégation du personnel au CSE.
Accords types de branche
Afin de faciliter la mise en place d’accords dans les PME et TPE, l’ordonnance encourage les branches professionnelles à élaborer des accords types. Ces modèles d’accords, adaptés aux spécificités des petites entreprises du secteur, peuvent être directement utilisés par les employeurs.
Ces accords
types peuvent être directement utilisés par les employeurs après consultation du personnel. Ils offrent un cadre pré-négocié qui facilite la mise en place d’accords adaptés aux réalités des petites structures, tout en garantissant un certain niveau de protection des salariés.
Cette approche vise à encourager le développement de la négociation collective dans les PME et TPE, où elle était jusqu’alors peu présente. Elle répond à une demande de flexibilité tout en maintenant un cadre protecteur pour les salariés.
Seuils d’effectifs et obligations sociales
L’ordonnance modifie également les règles relatives aux seuils d’effectifs qui déterminent certaines obligations sociales des entreprises. Elle introduit notamment un délai de cinq ans pour la mise en œuvre de nouvelles obligations liées au franchissement d’un seuil d’effectif.
Concrètement, une entreprise qui atteint ou dépasse un seuil d’effectif dispose désormais de cinq années consécutives pour se conformer aux obligations associées à ce nouveau seuil. Cette mesure vise à lever les freins au développement des PME, en leur donnant plus de temps pour s’adapter aux nouvelles contraintes réglementaires.
Par ailleurs, l’ordonnance harmonise les modes de calcul des effectifs pour diverses obligations sociales, simplifiant ainsi la gestion administrative pour les entreprises. Cette harmonisation contribue à rendre le droit du travail plus lisible et plus prévisible pour les employeurs.
Jurisprudence et applications pratiques post-ordonnance
Décisions de la cour de cassation
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur plusieurs aspects de la réforme, clarifiant ainsi son application pratique. Une des décisions les plus marquantes concerne le barème des indemnités prud’homales.
En mai 2019, la Cour de cassation a validé le principe du barème, estimant qu’il n’était pas contraire aux conventions internationales. Cette décision a conforté la sécurité juridique recherchée par la réforme. Cependant, la Cour a également précisé que les juges pouvaient, dans des cas exceptionnels, s’écarter du barème si son application causait un préjudice disproportionné au salarié.
La jurisprudence post-ordonnance joue un rôle crucial dans l’interprétation et l’application concrète des nouvelles dispositions du Code du travail.
D’autres décisions importantes ont porté sur la mise en place et le fonctionnement du CSE, précisant notamment les modalités de consultation de cette nouvelle instance et les conditions de désignation de ses membres.
Cas d’étude : l’affaire uber et le statut d’auto-entrepreneur
Bien que ne découlant pas directement de l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’affaire Uber illustre les défis posés par les nouvelles formes de travail dans le contexte juridique actuel. En mars 2020, la Cour de cassation a requalifié la relation entre Uber et un de ses chauffeurs en contrat de travail.
Cette décision, qui s’appuie sur l’existence d’un lien de subordination, a des implications importantes pour l’économie des plateformes. Elle souligne la nécessité d’adapter le droit du travail aux réalités émergentes de l’économie numérique, un défi que l’ordonnance de 2017 n’a que partiellement relevé.
L’affaire Uber pose la question de la pertinence des catégories traditionnelles du droit du travail (salarié vs indépendant) face aux nouvelles formes d’organisation du travail. Elle invite à réfléchir à de nouveaux statuts intermédiaires qui pourraient offrir plus de flexibilité tout en garantissant une protection sociale adéquate.
Adaptations des conventions collectives
Suite à l’ordonnance du 22 septembre 2017, de nombreuses branches professionnelles ont engagé des négociations pour adapter leurs conventions collectives au nouveau cadre légal. Ces adaptations concernent notamment la mise en place du CSE et la définition des thèmes sur lesquels l’accord de branche prime sur l’accord d’entreprise.
Certaines branches ont saisi l’opportunité offerte par la réforme pour renégocier en profondeur leurs conventions, y intégrant de nouvelles dispositions sur le télétravail, la qualité de vie au travail ou encore la gestion des parcours professionnels. Ces évolutions témoignent de la capacité du dialogue social à s’emparer des nouveaux enjeux du monde du travail.
Cependant, le processus d’adaptation des conventions collectives s’est révélé complexe et chronophage dans certains secteurs. La nécessité de trouver un équilibre entre les nouvelles possibilités offertes par la loi et le maintien des acquis conventionnels a parfois conduit à des négociations difficiles.
En définitive, l’ordonnance du 22 septembre 2017 a profondément remanié le paysage des relations de travail en France. Si elle offre de nouvelles opportunités de flexibilité et d’adaptation pour les entreprises, elle soulève également des défis en termes de protection des salariés et d’équilibre du dialogue social. L’évolution de la jurisprudence et des pratiques dans les années à venir sera déterminante pour évaluer pleinement l’impact de cette réforme majeure du droit du travail.